Bois et feu : un comportement mesurable et maîtrisable
On imagine souvent le bois comme un matériau fragile, qui s’enflamme aussitôt exposé aux flammes. Pourtant, la réalité est bien différente. Lorsqu’il brûle, le bois se carbonise lentement et de manière prévisible, créant une couche protectrice qui retarde la propagation du feu et conserve sa résistance mécanique. Cette particularité unique explique pourquoi il peut répondre aux normes de sécurité les plus strictes (REI 30, REI 60, REI 90). Loin d’être un point faible, son comportement progressif face à la chaleur en fait un allié méconnu de la sécurité incendie. Alors, comment ce matériau vivant réagit-il vraiment au feu, et pourquoi surprend-il encore aujourd’hui les ingénieurs comme les architectes ?
Le bois brûle… mais pas comme vous l’imaginez !
On pense souvent que le bois s’embrase dès le premier contact avec le feu. En réalité, son comportement est plus complexe. S’il est bien un matériau combustible, sa réaction dépend d’une combinaison de facteurs : essence, densité, porosité, teneur en résine, mais aussi forme et dimensions des éléments utilisés. Comprendre ces paramètres permet d’anticiper son comportement et de transformer une faiblesse apparente en levier de sécurité maîtrisée.
Pourquoi le bois brûle-t-il vraiment, et qu’est-ce qui influence sa combustion ?
Le bois est naturellement combustible, mais il ne s’enflamme pas aussi vite qu’on l’imagine. Son embrasement dépend de plusieurs paramètres : l’essence choisie, sa densité, sa teneur en résine ou encore la forme des éléments utilisés en construction. Certains bois, comme le pin, s’enflamment rapidement, tandis que d’autres, comme le chêne, opposent une résistance étonnante. En construction, comprendre ces différences permet de mieux anticiper le comportement d’une structure en cas d’incendie.
En savoir plus sur : « Pourquoi la combustion du bois varie selon son essence et sa structure »
Réaction au feu suivant les essences : résineux vs feuillus
- Les résineux (pin, épicéa) brûlent plus vite. Leur faible densité et leur richesse en résine — des composés volatils — favorisent l’embrasement et la propagation des flammes.
- Les feuillus denses (chêne, hêtre) résistent davantage. Leur structure compacte et leur faible proportion de substances extractibles ralentissent leur combustion.
L’influence de la forme et des éléments bois :.
- Des sections fines, angles vifs ou fissures multiplient la surface exposée, ce qui accélère l’inflammation.
- Les pièces massives aux formes arrondies s’enflamment plus lentement et conservent leur stabilité plus longtemps.
La température critique d’embrasement
Contrairement aux idées reçues, le bois ne s’enflamme pas instantanément. Il lui faut atteindre une température critique comprise entre 250 et 300 °C, et être soumis à une source de chaleur intense et prolongée. C’est cette phase de déclenchement qui conditionne la suite du processus de combustion.
📌 À retenir : le bois brûle, mais pas toujours de la même manière. Ses réactions varient selon l’essence, la densité et la géométrie des éléments, des critères essentiels à prendre en compte dès la conception architecturale.
Quelles sont les étapes de transformation du bois sous l’effet du feu ?
Le bois ne s’embrase pas d’un seul coup. Avant que les flammes n’apparaissent, il traverse une série de phases thermiques successives, chacune modifiant sa structure et son comportement. Ce processus progressif, loin d’être aléatoire, est prévisible et mesurable. C’est ce qui permet aux ingénieurs de dimensionner des structures bois capables de résister longtemps à un incendie, en tenant compte des vitesses de carbonisation et des seuils critiques.

En savoir plus sur : « Les phases thermiques du bois face au feu »
1. Phase de séchage (≈ 100 °C)
Le bois contient toujours un certain pourcentage d’humidité (souvent 10 à 18 %). Exposé à la chaleur, il atteint rapidement 100 °C, température à laquelle l’eau interne commence à s’évaporer. Cette étape agit comme un tampon thermique : l’énergie sert d’abord à vaporiser l’eau, ce qui ralentit la montée en température du matériau.
2. Décomposition thermique (180 à 350 °C)
Une fois sec, le bois entre en phase de dégradation de ses composants principaux : cellulose, hémicellulose et lignine. Dès 180 °C, ces chaînes moléculaires se désorganisent. Le matériau se ramollit et libère des gaz combustibles par pyrolyse. Vers 350 °C, la structure interne est fortement altérée, mais l’embrasement n’est pas encore automatique.
3. Inflammation (250 à 300 °C selon conditions)
Lorsque la chaleur se prolonge, le bois atteint son point d’auto-inflammation. Celui-ci varie selon l’essence, la teneur en oxygène et la ventilation. Les résineux secs peuvent s’embraser dès 250 °C, tandis que d’autres essences nécessitent environ 300 °C. C’est à ce stade que les flammes deviennent visibles.
4. Carbonisation progressive (au-delà de 300 °C)
Contrairement à l’acier qui perd brutalement sa résistance, le bois se consume en surface à un rythme régulier. Une couche noire de carbone, dite sacrificielle, se forme. Cette couche agit comme un isolant thermique, protégeant la partie interne du bois et ralentissant la propagation du feu.
Vitesses de carbonisation mesurées :
- Bois massif : ≈ 0,8 mm/min
- Bois lamellé-collé : ≈ 0,65 mm/min
Ces valeurs, reproductibles en laboratoire, permettent de calculer la section résiduelle porteuse d’un élément en feu et de garantir sa tenue selon les normes (REI 30, REI 60, REI 90).
👉 À retenir : le bois, bien qu’inflammable, ne s’effondre pas brutalement. Sa réaction lente et prévisible constitue un véritable atout sécuritaire lorsqu’il est intégré à la conception architecturale.
Comment ralentir l’inflammabilité du bois et sécuriser vos projets ?
Le bois est combustible, mais son inflammabilité peut être contrôlée et réduite grâce à des techniques éprouvées. Ces méthodes ne retirent rien à ses qualités esthétiques et écologiques, tout en répondant aux exigences de sécurité. Certaines stratégies s’intègrent dès la phase de conception, d’autres se mettent en place lors du chantier. Bien choisies, elles prolongent la résistance du bois et renforcent la sécurité des bâtiments.
En savoir plus sur : « Les techniques pour maîtriser l’inflammabilité du bois »
1. Surdimensionnement des sections
La première stratégie consiste à anticiper la vitesse de carbonisation dans les calculs. En choisissant des poutres ou poteaux plus épais, on crée une marge de matière résiduelle. Même si la surface brûle, le cœur structurel continue de supporter la charge, garantissant la stabilité de l’ouvrage.
2. Traitements ignifuges
Plusieurs produits techniques retardent l’embrasement du bois :
- Vernis intumescents : gonflent sous l’effet de la chaleur et forment une barrière protectrice.
- Lasures et mousses ignifuges : ralentissent la montée en température.
- Traitement en autoclave : imprègne le bois en profondeur avec des retardateurs de flamme.
Tous ces produits doivent respecter les normes européennes (EN 13501-1) et être adaptés à l’usage prévu : intérieur/extérieur, structure ou décoration.
3. Protection passive
Autre solution : encapsuler le bois dans des matériaux non combustibles. Plaques de plâtre, laine de roche ou béton allégé jouent le rôle de bouclier mécanique, ralentissant considérablement la propagation du feu.
4. Méthode Shou Sugi Ban (Yakisugi)
Cette technique japonaise traditionnelle consiste à brûler volontairement la surface du bois. La couche carbonisée obtenue est inerte et difficile à rallumer. Elle protège le cœur du bois tout en offrant une esthétique unique et contemporaine, particulièrement prisée pour les bardages extérieurs.

À retenir : combiner plusieurs stratégies (dimensionnement, traitement, encapsulage) permet d’optimiser la résistance au feu du bois sans renoncer à ses qualités naturelles et durables.
Le bois brûle-t-il vraiment si vite ? Ses atouts et ses limites face au feu
La résistance du bois face au feu repose sur un mécanisme bien documenté : la carbonisation progressive. Lors d’un incendie, une couche noire et friable, appelée couche sacrificielle, se forme en surface. Ce bouclier thermique ralentit la pénétration de la chaleur dans le cœur du matériau. Le bois continue de brûler, certes, mais à un rythme lent et prévisible, ce qui change totalement la perception de sa sécurité.
Des vitesses de combustion du bois bien connues : un atout en cas d’incendie ?
La force du bois face au feu réside dans sa prévisibilité. Sa vitesse de carbonisation est parfaitement connue : environ 0,8 mm/min pour le bois massif et 0,65 mm/min pour le bois lamellé-collé. Ces données permettent aux ingénieurs de calculer avec précision la section portante résiduelle après un temps donné d’exposition aux flammes. Ainsi, le comportement du bois reste mesurable et contrôlable, même en pleine combustion.
En savoir plus sur : « Comment la vitesse de carbonisation garantit la sécurité des structures bois »
Vitesses de carbonisation détaillées
- Bois massif : ≈ 0,8 mm/min
- Bois lamellé-collé : ≈ 0,65 mm/min
Ces valeurs, établies en laboratoire, servent de référence pour les calculs de tenue au feu. Elles permettent de dimensionner une poutre, un poteau ou une structure entière afin d’assurer leur stabilité pendant 30, 60 ou 90 minutes, conformément aux normes.
Exemple concret : un poteau soumis aux flammes
Prenons un poteau carré de 30 × 30 cm exposé au feu pendant 30 minutes sur ses quatre faces.
- Vitesse moyenne de carbonisation : 0,7 mm/min
- Perte de matière par face : ≈ 21 mm
- Section résiduelle : 25,8 × 25,8 cm
Résultat : le poteau conserve une capacité portante fiable, alors que d’autres matériaux comme l’acier perdent brutalement leur résistance lorsqu’ils atteignent des températures critiques. Et donc, grâce à ces vitesses constantes, le bois offre un comportement lent, régulier et prévisible face au feu ; Ce qui représente un avantage décisif en sécurité incendie.
Le bois garde-t-il vraiment sa capacité portante en cas d’incendie ?
On pense souvent que le bois s’effondre rapidement face au feu. Pourtant, même partiellement carbonisé, il conserve une capacité portante remarquable. Grâce à sa faible conductivité thermique, son cœur reste plus froid plus longtemps que celui des métaux. Contrairement à l’acier qui peut céder brutalement dès 600 °C, le bois perd ses performances de manière progressive et visible, ce qui laisse un temps précieux pour évacuer en sécurité.
En savoir plus sur : « Pourquoi le bois conserve sa résistance structurelle face au feu »
Un cœur qui reste froid plus longtemps
Le bois conduit très mal la chaleur : sa conductivité thermique se situe autour de 0,12 à 0,25 W/m·K, contre environ 50 W/m·K pour l’acier. Résultat : la chaleur met plus de temps à atteindre le cœur des éléments massifs, ce qui maintient leur stabilité mécanique.
Pas de fusion ni de torsion soudaine
Contrairement aux métaux, le bois ne fond pas et ne se déforme pas brutalement sous l’effet de la chaleur. Son affaiblissement reste progressif et lisible : une poutre se consume lentement en surface mais continue de tenir en son centre, offrant aux occupants et aux pompiers un délai de réaction vital.
Une baisse de résistance limitée
Dans un incendie moyen, la résistance mécanique du bois non carbonisé diminue de seulement 10 à 15 %. Cette perte, relativement modérée, permet encore d’assurer la stabilité de nombreux scénarios structurels, contrairement à l’acier qui peut s’effondrer soudainement.
Le bois face aux feu : où sont ses vraies vulnérabilités ?
Même si le bois surprend par sa résistance au feu, il n’est pas exempt de contraintes. Certains éléments plus fins s’enflamment rapidement, et certains assemblages peuvent céder sous la chaleur. Dans des contextes sensibles comme les établissements recevant du public (ERP), il reste nécessaire d’appliquer des solutions complémentaires. Connaître ces limites, c’est la clé pour exploiter le bois en toute sécurité sans le surestimer.
En savoir plus sur : « Les points faibles du bois face aux flammes »
Les éléments fins, plus vulnérables
Les lambris, bardages ou panneaux légers n’offrent pas la même tenue au feu que des poutres massives. Leur faible épaisseur augmente la surface exposée et accélère l’embrasement. Dans certains cas, leur combustion peut contribuer à propager le feu.
Les assemblages métalliques fragilisés
Vis, clous ou connecteurs métalliques jouent un rôle essentiel dans la structure. Mais sous l’effet de la chaleur, ces points de liaison peuvent perdre rapidement leur résistance et provoquer une rupture prématurée de l’assemblage. C’est pourquoi leur dimensionnement et leur protection doivent être anticipés.
La nécessité des traitements ignifuges
Pour les usages sensibles — cinémas, écoles, ERP —, les normes exigent souvent un traitement ignifuge. Vernis intumescents, lasures spéciales ou imprégnations en autoclave permettent de retarder l’inflammation et de garantir la conformité réglementaire.
À retenir : le bois reste un matériau fiable face au feu, à condition de respecter ses zones de vulnérabilité et de recourir à des protections adaptées.
Réglementation : calcul et exigences de la tenue au feu
La réglementation incendie encadre de manière stricte la résistance au feu des structures bois. L’objectif est clair : garantir un temps d’évacuation suffisant et limiter les risques d’effondrement. Mais ces exigences ne sont pas uniformes : elles dépendent de la typologie du bâtiment, de son usage et du public accueilli. Pour les concepteurs, cela implique de prouver par le calcul que le bois utilisé répond bien aux normes en vigueur. C’est ce qui fait toute la différence entre un matériau combustible perçu comme fragile et un matériau maîtrisé, parfaitement compatible avec la construction réglementée.
Que dit réellement la loi sur la tenue au feu du bois ?
La réglementation incendie encadre strictement la résistance au feu des structures. L’objectif est simple : garantir un temps suffisant pour l’évacuation des occupants avant tout risque d’effondrement. Les seuils exigés ne sont pas uniformes : ils varient selon le type de bâtiment, son usage et son exposition au public. Connaître ces règles est essentiel pour intégrer le bois en toute conformité dans un projet de construction.
En savoir plus sur : « Les normes de résistance au feu appliquées aux structures bois »
Maisons individuelles
Dans le résidentiel, les exigences restent limitées. Une résistance minimale de 15 minutes est imposée pour assurer la stabilité des éléments porteurs, temps jugé suffisant pour évacuer en cas d’incendie domestique.
ERP et bâtiments à risques spécifiques
Les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les bâtiments à forte affluence (cinémas, écoles, centres commerciaux) doivent respecter des seuils plus élevés : 30, 60 voire 90 minutes, selon leur catégorie et leur hauteur (y compris les IGH – Immeubles de Grande Hauteur).
Bâtiments industriels et logistiques
Dans le secteur industriel, les critères dépendent souvent du volume à protéger et de la nature des biens stockés. Les entrepôts logistiques, par exemple, peuvent être soumis à des seuils spécifiques renforcés.
La base réglementaire : norme EN 13501-2
En France, la réglementation s’appuie sur la norme européenne EN 13501-2, qui définit les performances de résistance au feu selon trois critères :
- R : résistance mécanique (maintenir la stabilité).
- E : étanchéité aux flammes (empêcher la propagation).
- I : isolation thermique (limiter la chaleur transmise).
👉 Les éléments bois porteurs doivent donc être classés REI 30, REI 60 ou REI 90, en fonction des exigences propres au projet. Le bois peut donc parfaitement répondre aux normes les plus strictes, à condition de prouver sa tenue au feu par le calcul et de l’intégrer dans une conception réglementaire dès l’amont.
Comment calcule-t-on la tenue au feu du bois ?
Le bois se distingue par une cinétique de dégradation lente et régulière, qui rend son comportement face au feu à la fois prévisible et mesurable. Cette particularité permet aux ingénieurs de modéliser avec précision la tenue au feu des structures bois. Intégrée dès la conception, elle garantit que les bâtiments respectent les exigences réglementaires, à condition d’utiliser les bons paramètres de calcul.

En savoir plus sur : « Les méthodes de calcul de la tenue au feu des structures bois »
Le principe de base : la vitesse de carbonisation
Tout repose sur une donnée centrale : la vitesse de carbonisation, généralement estimée à 0,7 mm/min pour du bois standard. Cette valeur permet de déterminer :
- la section carbonisée après un temps donné,
- la section résiduelle utile qui continue de porter la charge,
- la section initiale nécessaire pour compenser la perte attendue.
Exemple concret de calcul
Un poteau de 30 × 30 cm exposé à un feu pendant 30 minutes sur ses 4 faces :
- Perte estimée : ≈ 21 mm par face (0,7 mm/min × 30 min).
- Section utile restante : 25,8 × 25,8 cm.
Cette section résiduelle est ensuite utilisée dans les vérifications structurelles pour garantir que la pièce supporte toujours la charge pendant la durée d’exposition prévue.
Des outils normalisés pour l’ingénierie bois
Ces calculs ne se font pas “au doigt mouillé”. Ils sont intégrés dans des logiciels spécialisés (Cadwork, RFEM, Robot, etc.), qui appliquent les normes en vigueur. Dès le dépôt de permis de construire, les concepteurs peuvent ainsi prouver la conformité des ouvrages bois aux exigences incendie, sans sacrifier l’esthétique ni la matérialité bois.
Grâce à la précision du calcul, le bois ne se contente pas de répondre aux normes incendie, il les anticipe, offrant aux architectes une sécurité mesurable et contrôlée.
Application concrète : le bois, un matériau sûr avec méthode
La théorie ne suffit pas : ce qui compte, c’est la preuve par l’usage. Le bois, souvent perçu comme vulnérable au feu, s’impose en réalité comme un matériau sûr lorsqu’il est correctement dimensionné et protégé. Son comportement mesurable permet aux architectes et ingénieurs d’en faire un choix fiable, adapté aussi bien aux maisons individuelles qu’aux bâtiments publics exigeants.
Pourquoi choisir le bois malgré le risque d’incendie ?
À l’heure de la transition écologique, le bois séduit par sa durabilité, mais aussi par sa performance face au feu lorsqu’il est employé avec méthode. Son grand atout réside dans la régularité de sa combustion : lente, homogène et prévisible. Cela permet de dimensionner les poutres, poteaux et structures en toute sécurité, sans craindre un effondrement soudain.
En savoir plus sur : « Les avantages du bois comme matériau de construction face au feu »
Une combustion qui reste un atout
Contrairement aux idées reçues, la combustion lente du bois est un garde-fou naturel. Elle donne le temps nécessaire pour calculer, prévoir et adapter les sections aux classes de résistance au feu (REI 30, 60 ou 90).
Une stabilité mécanique au-delà des flammes
Même après son point d’inflammation, le bois conserve une part importante de ses propriétés mécaniques. Son faible coefficient de dilatation et sa conductivité thermique modérée limitent les déformations. Cela prolonge la stabilité structurelle même dans des conditions extrêmes.
Un choix stratégique pour les projets modernes
Le bois ne s’effondre pas sans prévenir : il se consume progressivement, laissant aux occupants et aux secours un temps de réaction précieux. C’est ce qui autorise son usage dans des projets exigeants, y compris les ERP et les bâtiments collectifs, tout en alliant esthétique, performance thermique et sécurité.
À retenir : loin d’être une faiblesse, le feu est un paramètre maîtrisable du bois, transformé en avantage par une conception intelligente.
Quelles sont les bonnes pratiques pour sécuriser les chantiers bois face au feu ?
La sécurité incendie dans la construction bois ne repose pas seulement sur les propriétés du matériau, mais aussi sur les bonnes pratiques mises en œuvre dès le chantier. Chaque étape — du dimensionnement à la finition — contribue à garantir une tenue au feu fiable et durable. Intégrer ces leviers techniques dès la conception permet de transformer le bois en un matériau à la fois performant, esthétique et conforme aux exigences réglementaires.
En savoir plus sur : « Les meilleures pratiques pour protéger le bois en construction »
Dimensionner avec précision
La perte prévisible liée à la carbonisation doit être anticipée dès la conception. Grâce à des logiciels spécialisés, il est possible de calculer la section résiduelle et de dimensionner les éléments porteurs (poteaux, poutres, solives) de manière optimale.
Choisir les bonnes essences
Toutes les essences n’offrent pas la même résistance au feu. Les bois durs (chêne, hêtre) présentent une meilleure tenue que les résineux, et seront privilégiés dans les zones sensibles comme les escaliers, les gaines techniques ou les locaux à risques.
Appliquer des traitements ignifuges certifiés
Vernis intumescents, lasures spécifiques ou traitements en autoclave permettent de ralentir l’inflammation. Ces produits doivent être adaptés aux conditions d’usage (humidité, exposition) et porter les certifications européennes (type EN 13501).
Envelopper les structures
L’encapsulation des éléments bois avec des matériaux coupe-feu (plaques de plâtre haute densité type F, laine minérale, béton allégé) retarde significativement leur exposition aux flammes.
Soigner les détails d’exécution
Les assemblages, percements techniques et angles vifs constituent des points faibles. Sans protection spécifique (collerettes intumescentes, gaines renforcées, joints adaptés), ils deviennent des vecteurs de propagation du feu.
Exemple concret : dans une maison à ossature bois, il est recommandé d’utiliser des doublages intérieurs en plaques de plâtre REI 30, et de protéger toutes les traversées de planchers avec des collerettes intumescentes pour garantir une sécurité optimale.
📌 À retenir : c’est la combinaison de ces bonnes pratiques — calcul, choix du bois, traitement, protection et exécution soignée — qui fait du bois un matériau sûr et maîtrisable en cas d’incendie.
Quels conseils concrets pour réussir un projet en bois en intégrant la sécurité incendie ?
Réussir un projet bois ne se limite pas à l’esthétique ou à la performance thermique. La prise en compte du risque incendie doit être intégrée dès les premières phases d’étude. Cela suppose d’anticiper les classes de résistance attendues, de sélectionner des produits certifiés et de s’entourer des bons partenaires. Cette approche globale permet de garantir non seulement la sécurité, mais aussi la valeur architecturale et technique du projet.
En savoir plus sur : « Les clés pour concevoir un projet bois conforme aux normes incendie »
Anticiper les classes de résistance
Dès la conception, il faut déterminer les classes REI adaptées au type de bâtiment (REI 30, 60 ou 90). Une maison individuelle n’aura pas les mêmes exigences qu’un ERP ou un immeuble tertiaire.
Sélectionner des produits certifiés
Essences résistantes, traitements ignifuges homologués, composants certifiés : le choix des matériaux conditionne la conformité. Les certifications européennes (EN 13501) assurent la validité des solutions mises en œuvre.
Collaborer avec des partenaires spécialisés
Architectes, bureaux d’études et fournisseurs spécialisés sont des alliés indispensables. Leur expertise garantit que les solutions retenues sont éprouvées et adaptées aux contraintes du projet.
Des solutions prêtes à l’emploi
De plus en plus de fournisseurs proposent des bois pré-traités et certifiés EI30 à EI90, prêts à être intégrés directement dans les ouvrages. Ces solutions simplifient la conformité, réduisent les délais et augmentent la fiabilité des chantiers.
À retenir : dans un contexte de projets ambitieux, la maîtrise de la tenue au feu est un critère de performance et un levier de différenciation. Bien entouré, un maître d’ouvrage peut non seulement sécuriser sa construction, mais aussi valoriser la technicité du bois dans un projet architectural exigeant.
Bois et sécurité incendie : un matériau fiable si l’on intègre ses règles du jeu.
Le bois est un matériau combustible, mais sa combustion est lente, régulière et prévisible. Sa réaction au feu peut être quantifiée et calculée, et de nombreuses solutions existent pour renforcer sa tenue : traitements, protections passives, choix d’essences adaptées. À condition d’intégrer ces paramètres dès la phase de conception, le bois reste un matériau sûr, fiable et performant, même face aux contraintes incendie.
Construire en bois ne signifie pas ignorer le risque incendie : c’est l’intégrer intelligemment dans la conception, avec méthode et rigueur. Tout commence par le choix de l’essence et la prise en compte des normes adaptées.
Faites-vous accompagner par des professionnels dès la conception. Leur expertise vous aidera à sélectionner des essences naturellement résistantes ou adaptées à des traitements certifiés. Bénéficier d’un conseil ciblé en amont, c’est vous assurer d’une sécurité maîtrisée et durable tout au long de votre projet.
Pour aller plus loin :
- Découvrez notre article sur la résistance du bois face à l’eau pour comprendre l’influence de l’eau et de l’humidité sur ses performances mécaniques et thermiques.
- Explorez comment le bois résiste aux séismes pour identifier les zones de vulnérabilité structurelle du bois face aux sollicitations extrêmes.
- Consultez notre article sur la santé du bois pour évaluer l’impact du bois sur la qualité de l’air intérieur et la santé.







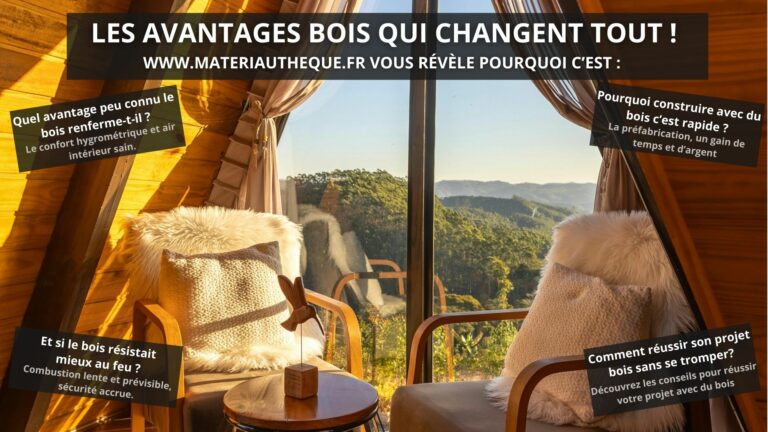







[…] Résistance au feu du bois […]