Le béton est réputé pour son excellent comportement face au feu, une propriété déterminante dans le choix des matériaux pour la construction d’ouvrages publics, d’habitations ou de bâtiments industriels. Incombustible, stable à haute température, et sans émission toxique, le béton s’impose comme un rempart naturel contre les incendies. Mais cette résistance est-elle systématique ? De quoi dépend-elle exactement ? Et comment l’optimiser sans surcoût inutile ?
Les normes de sécurité incendie se durcissent. Vous devez donc connaître la réaction du béton aux températures extrêmes. Architecte, ingénieur, artisan ou particulier, vous gagnez en maîtrise en comprenant cette dynamique. Le béton, pourtant perçu comme inerte, suit une cinétique thermique complexe. Sa composition, son humidité, ses armatures et la durée d’exposition au feu influencent directement sa tenue.
Ce guide vous aide à mieux comprendre la résistance au feu du béton. Il présente ses points forts, ses limites et les moyens concrets pour améliorer sa tenue face aux incendies. Vous découvrez des solutions fiables pour renforcer sa performance dans les zones à risque. Que vous construisiez, rénoviez ou choisissiez vos matériaux, ce contenu vous apporte des repères techniques clairs et des conseils pratiques pour garantir la sécurité de vos ouvrages.
Pourquoi le béton est-il naturellement résistant au feu ?
Le béton offre une excellente résistance au feu, qui repose principalement sur sa nature minérale, sa faible conductivité thermique et son absence de composants combustibles. Ces caractéristiques en font un matériau de référence pour construire des bâtiments sûrs et durables, même en cas d’incendie majeur.
Un matériau incombustible par essence
Le béton est classé M0 selon l’Eurocode NF EN 1992-1-2, c’est-à-dire incombustible. Il ne propage ni flamme, ni fumée, ni gaz toxique en cas de montée en température. Cette particularité est due à la composition même du béton : un mélange d’eau, de ciment, de sable et de granulats, sans aucune matière organique. Contrairement à d’autres matériaux comme le bois ou certains polymères, il n’alimente pas le feu, ce qui limite la propagation des flammes.
Bon à savoir : même à très haute température, le béton ne dégage pas de substances nocives pour les occupants, ce qui le rend particulièrement adapté aux lieux publics, écoles, hôpitaux ou ERP (établissements recevant du public).
Une conductivité thermique très faible
Avec une conductivité thermique moyenne de 1,5 W/m.K, le béton ralentit fortement la transmission de la chaleur à l’intérieur de la structure. Autrement dit, même exposé à une température de 1000°C pendant 1 heure, la chaleur met du temps à pénétrer profondément dans la matière :
- à 1,5 cm de profondeur, le béton atteint environ 500°C,
- à 3 cm, il descend à 350°C,
- à 7,5 cm, on tombe sous les 100°C.
Cette lenteur de propagation permet d’allonger le délai d’évacuation des personnes, et de limiter la déformation des structures le temps d’intervention des secours.
Cette inertie thermique est un atout majeur du béton par rapport à d’autres matériaux comme l’acier (MAc-3C) qui, bien que résistant mécaniquement, perd rapidement ses propriétés à haute température (dès 500°C).
Un excellent maintien des propriétés mécaniques
Contrairement à certains matériaux qui s’effondrent très rapidement sous l’effet de la chaleur, le béton conserve une partie significative de sa capacité portante même en cas d’exposition prolongée aux flammes. Par exemple, à 750°C, un béton non armé peut conserver jusqu’à 35 % de sa résistance mécanique initiale, ce qui garantit une stabilité structurelle suffisante pour éviter un effondrement brutal.
Cette stabilité rend possible l’évacuation, limite les dégâts secondaires (chute d’étages, effondrement de façades…) et facilite la réhabilitation post-incendie dans certaines configurations.
En résumé :
Le béton résiste naturellement au feu grâce à sa masse thermique élevée, sa faible conductivité, et l’absence de composants inflammables. Il est ainsi reconnu comme un des matériaux les plus fiables en sécurité incendie.
Comment le béton se comporte-t-il selon les paliers de température ?
Le comportement du béton face à la montée en température suit une logique physico-chimique bien connue. Chaque palier thermique entraîne des réactions spécifiques qui modifient plus ou moins durablement la structure du béton. Comprendre ces seuils est crucial pour anticiper la résistance au feu réelle des ouvrages et adapter les prescriptions de conception.
De 80 °C à 300 °C : début des transformations internes
- À partir de 80 °C, l’eau capillaire présente dans les pores de surface commence à s’évaporer. Cette évaporation est progressive et ne dégrade pas encore la cohésion de la matrice cimentaire.
- Entre 100 °C et 300 °C, c’est l’eau liée chimiquement dans les hydrates du ciment (notamment l’ettringite, un minéral hydraté à base de sulfate d’alumine et de chaux) qui commence à se désolidariser. Cela entraîne une légère perte de cohésion, mais le béton reste encore stable mécaniquement.
- À ce stade, le risque d’explosion est faible, tant que le béton n’est pas trop humide.
Info technique : sous 300 °C, les microfissures restent superficielles. Les performances mécaniques générales sont conservées.
De 300 °C à 600 °C : seuil critique pour la résistance
- À partir de 300 °C, les C-S-H (silicates de calcium hydratés) — éléments clés de la résistance du béton — commencent à se déshydrater. Cet état qui provoque une dégradation structurelle progressive.
- Entre 450 °C et 500 °C, c’est la portlandite (Ca(OH)₂) qui se décompose en chaux vive et en vapeur d’eau. Cette transformation chimique libère des tensions internes, aggravant les fissurations.
- Le béton peut alors perdre jusqu’à 60 % de sa masse initiale, et les granulats à base de quartz amorcent leur changement de phase (passage du quartz alpha au quartz bêta), créant des effets de dilatation différenciée.
Concrètement : à ce niveau de température, une dalle exposée directement aux flammes ne peut plus être considérée comme structurellement sûre sans vérification poussée.
Au-delà de 600 °C : désintégration accélérée
- Au-delà de 600 °C, toute l’eau chimiquement liée est évacuée. La structure est désormais totalement asséchée. À ce stade, si l’incendie se déclenche en RDC, c’est le bâtiment qui est en mesure de s’effondrer.
- À 700 °C, les carbonates (CaCO₃) contenus dans les granulats se décarbonatent en libérant de la chaux. A ce stade, l’ossature du béton s’affaiblit. . À cette température, les métaux perdent toute leur solidité. Les bétons armés commencent donc à perdre une grande partie de ses capacités. Si la structure ne s’effondre pas encore dans certains cas, la fumée et déjà très toxique.
- Au-delà de 1100 °C, on observe des phénomènes de frittage. Les éléments commencent à fondre localement, les granulats fusionnent, et le béton perd toute tenue mécanique.
À ces températures, seuls les murs épais en béton non armé peuvent encore offrir une résistance minimale, mais la réutilisation des structures est très improbable.
Ce qu’il faut retenir :
La résistance du béton au feu diminue avec la température, par palier. Jusqu’à 300 °C, il conserve une stabilité importante. Au-delà, les réactions chimiques de déshydratation, de décomposition et de transformation cristalline réduisent progressivement sa résistance. Dès 600 °C, la perte de performance devient critique, et à **1200 °C, le béton est considéré comme non fonctionnel.

Quels sont les facteurs qui influencent la résistance du béton au feu ?
La résistance au feu du béton dépend de nombreux paramètres, bien au-delà de sa simple composition. Température, durée d’exposition, configuration du bâtiment ou encore humidité interne. Chaque variable peut impacter la capacité du matériau à conserver ses propriétés mécaniques en cas d’incendie. Mieux comprendre ces facteurs permet de concevoir des structures à la fois ignifugées et durables.
L’humidité du béton : facteur de risque explosif
Le taux d’humidité résiduelle du béton est un facteur clé. Si celui-ci dépasse 3 %, le béton devient vulnérable à ce qu’on appelle un éclatement explosif. Ce phénomène survient lorsque la pression de la vapeur d’eau accumulée dans les pores excède la capacité de résistance interne du béton. Résultat : un décollement brutal, parfois destructeur.
Astuce technique : pour limiter ce risque, les bétons résistants au feu sont enrichis en fibres de polypropylène (≈ 2 kg/m³). Ces fibres fondent autour de 160 °C, créant des micro-canaux qui facilitent l’évacuation de la vapeur.
Composition du béton et types d’ajouts
La formulation du béton a une influence directe sur sa tenue au feu. Plus sa porosité est élevée, plus la vapeur d’eau s’accumule dans ses pores. Cette particularité augmente les risques de fissuration thermique ou d’éclatement explosif. À l’inverse, un béton dense mais sans canal de dépressurisation devient lui aussi vulnérable.
Pour pallier cela, on introduit souvent des fibres de polypropylène (≈ 2 kg/m³) dans les mélanges. Ces fibres fondent autour de 160 °C, créant des micro-canaux qui permettent à la vapeur de s’échapper progressivement, évitant ainsi les surpressions internes.
Les formulations spécifiques pour la résistance au feu privilégient aussi :
- des rapports eau/ciment faibles pour limiter l’humidité résiduelle,
- des granulats résistants aux hautes températures (type basalte ou calcaire dense),
- et des adjuvants compatibles avec les conditions thermiques extrêmes.
À noter : des bétons ultra haute performance (BUHP) bien conçus, avec microfibres intégrées, présentent une résistance thermique bien supérieure à un béton standard.
Forme et configuration de la structure
Les dimensions et la configuration du bâtiment jouent un rôle déterminant dans le comportement du béton face aux flammes. Une structure massive conserve mieux sa stabilité, mais un environnement clos (sous-sol, cage d’ascenseur, tunnel) favorise une montée en température rapide et prolongée.
Un incendie en sous-sol représente un risque majeur. Les matériaux stockés, comme les cartons ou les produits combustibles, alimentent rapidement les flammes. La chaleur s’accumule, faute d’évacuation naturelle. La base du bâtiment, pourtant essentielle, devient alors la zone la plus exposée. Ce type de feu peut provoquer un effondrement par la base, surtout si les structures sont fines ou mal isolées.
Des solutions comme la mise en place de raidisseurs horizontaux bien répartis, notamment dans le cas de structures préfabriquées, permettent de :
- canaliser les déformations thermiques,
- éviter un effondrement par basculement externe,
- et surtout permettre une déformation progressive, offrant aux pompiers une meilleure lisibilité du danger et du temps d’intervention.
Exposition et refroidissement : un cycle thermique à gérer
La durée d’exposition au feu est évidemment un facteur majeur : plus elle est longue, plus les constituants du béton se décomposent. Les transformations chimiques s’enchaînent dès 300 °C (déshydratation des C-S-H), s’intensifient entre 450 et 600 °C (décomposition de la portlandite), et aboutissent à des altérations irréversibles du béton dès 700 °C (décarbonatation du calcaire et perte d’intégrité granulaire).
Mais l’après-feu est tout aussi critique. Un refroidissement trop rapide, notamment par arrosage abondant à l’eau froide, entraîne une variation thermique brutale entre le cœur encore chaud du béton et sa surface. Cela peut provoquer :
- une fissuration importante,
- une perte d’adhérence avec les armatures,
- et dans certains cas, un éclatement structurel.
En parallèle, la chaux vive (CaO) produite par la décomposition des carbonates réagit avec l’eau pour former de l’hydroxyde de calcium, un processus exothermique qui aggrave la fragilité du matériau.
En pratique : un refroidissement contrôlé (brumisation douce, ventilation progressive) est fortement recommandé après un incendie pour préserver l’intégrité du béton et faciliter d’éventuelles réparations.
Pour résumé : le béton offre une excellente tenue au feu, mais celle-ci dépend fortement :
- de sa formulation (granulats, fibres, rapport eau/ciment),
- de son environnement immédiat (espaces clos, sous-sols),
- et de la gestion thermique post-incendie (refroidissement progressif).
Cas particulier : le comportement du béton armé face au feu
Cas particulier : le comportement du béton armé face au feu
Le béton armé, souvent présenté comme le pilier des constructions modernes, associe la résistance à la compression du béton et la résistance à la traction de l’acier. Mais cette alliance n’est pas sans faille lorsqu’elle est soumise à des températures extrêmes. En cas d’incendie, l’acier devient le maillon faible. Sa sensibilité thermique, sa conductivité élevée et la façon dont il est enrobé dans le béton influencent directement la sécurité de la structure. C’est pourquoi ce cas particulier mérite un éclairage technique plus poussé.
L’acier : un talon d’Achille face à la chaleur
L’acier utilisé dans les armatures possède une conductivité thermique nettement supérieure à celle du béton : entre 50 et 60 W/m·K, contre seulement 1,5 à 2 W/m·K pour le béton. Cette différence de comportement thermique signifie que l’acier monte rapidement en température lors d’un feu, ce qui représente un risque structurel important.
Dès 400 °C, ses propriétés mécaniques commencent à se dégrader.
À 550 °C, sa résistance à la traction chute de moitié, compromettant l’intégrité des structures porteuses.
Et lorsque la température atteint 750 °C, cette résistance tombe à moins de 20 %, exposant le bâtiment à un risque d’effondrement rapide, surtout en présence de fortes charges.
Un autre problème lié à la présence d’acier : il accélère localement la montée en température du béton autour de lui. Cette diffusion rapide crée des gradients thermiques importants, favorisant fissuration, perte d’adhérence et, dans le pire des cas, éclatement de la structure.
C’est pourquoi un béton parfaitement formulé ne suffit pas : sans stratégie spécifique de protection des armatures, la sécurité globale reste compromise.
Rôle de l’enrobage béton pour protéger les armatures
La couche de béton qui entoure les armatures, appelée enrobage, joue un rôle essentiel de barrière thermique. Elle ralentit la transmission de la chaleur vers les aciers, retardant ainsi la perte de résistance mécanique.
Selon les données expérimentales et réglementaires :
- Un enrobage de 2 cm peut suffire pour une tenue au feu de 30 minutes.
- Un enrobage de 4 cm offre une protection efficace jusqu’à 2 heures.
- Pour des exigences supérieures (3 à 4 h), on préconise 5 à 6 cm minimum, en fonction de l’exposition au feu sur plusieurs faces.
Mais attention : l’efficacité de l’enrobage dépend aussi de la qualité du béton (compact, sans bulles d’air, avec faible porosité) et de sa mise en œuvre. Un défaut de coulage ou une ségrégation peut créer des zones de fragilité, compromettant l’homogénéité thermique.
🛠️ Astuce pro : dans les zones à haut risque (locaux techniques, sous-sols, IGH…), pensez à combiner enrobage renforcé + fibres polypropylène pour limiter l’éclatement et assurer une dissipation progressive de la vapeur interne.
Que dit l’Eurocode NF EN 1992-1-2 sur la tenue au feu ?
La norme NF EN 1992-1-2 (Eurocode 2 – Partie feu) fixe les règles de dimensionnement des structures en béton armé soumises à des températures élevées. Elle repose sur deux approches principales :
- Méthode tabulaire (simplifiée) : en fonction de l’usage du bâtiment et de la classe de résistance au feu requise (REI 30, 60, 90, 120…), des dimensions minimales des éléments (dalles, poteaux, poutres) et des épaisseurs d’enrobage sont proposées.
Exemple :
➤ Pour une résistance au feu de 2h (REI 120), une poutre en béton armé devra présenter :
- une hauteur ≥ 300 mm
- un enrobage ≥ 40 mm
- un béton de classe au moins C25/30
- Méthode analytique : pour les cas plus complexes, elle permet de modéliser la montée en température, la déformation et la perte de résistance de la structure. On y intègre :
- la courbe normalisée ISO 834 (montée en température en fonction du temps),
- les propriétés thermomécaniques du béton et de l’acier,
- et les sollicitations mécaniques réelles.
📏 Cette norme est aujourd’hui la référence absolue pour les bureaux d’études structure et les ingénieurs de sécurité incendie. Elle permet une conception rigoureuse, garantissant non seulement la résistance structurelle pendant le feu, mais aussi la stabilité au moment du refroidissement, phase souvent négligée.
En résumé :
Le béton armé reste performant en cas d’incendie, à condition de maîtriser la vulnérabilité de l’acier. L’enrobage béton joue ici un rôle clé, et la norme Eurocode fournit des outils clairs pour anticiper les comportements thermiques réels. C’est ce qui permet aujourd’hui d’ériger des bâtiments sûrs, même dans des contextes à fort risque incendie.
Peut-on améliorer la résistance au feu du béton ?
Même si le béton possède naturellement de bonnes propriétés face à la chaleur, il est tout à fait possible d’optimiser sa tenue au feu en agissant sur différents paramètres : formulation, épaisseur, nature des ajouts, renforts structurels… Voici les pistes d’amélioration à envisager pour des constructions encore plus performantes face à un incendie.
Choix du béton : ZVB, BHP, béton fibré…
Certains bétons sont spécifiquement formulés pour offrir une meilleure résistance thermique et une réaction maîtrisée aux températures extrêmes. C’est notamment le cas :
- du béton ZVB (zéro vibration béton), très compact, qui présente une moindre porosité et limite ainsi les risques de montée en pression interne ;
- du béton à haute performance (BHP), dont la densité et les résistances mécaniques initiales ralentissent la propagation des fissures ;
- ou encore des bétons fibrés, souvent enrichis de fibres métalliques ou minérales qui renforcent leur cohésion et leur intégrité structurelle en cas de montée en température.
Ce type de choix permet une adaptation du béton selon l’usage final (dalles de parking, murs coupe-feu, tunnels, etc.) et le niveau de performance attendu.
Ajouts de polypropylène : une barrière anti-éclatement
L’un des problèmes majeurs en cas d’incendie est le risque d’éclatement du béton, causé par la montée en pression de la vapeur d’eau piégée. Pour y remédier, on intègre souvent 2 kg/m³ de fibres de polypropylène au mélange. Ces fibres, fondant autour de 160 °C, créent de micro-canaux d’évacuation de la vapeur, réduisant la pression interne et limitant le risque d’explosion.
Cette solution est particulièrement préconisée pour les bétons à très faible ratio eau/ciment, souvent utilisés dans les ouvrages préfabriqués ou les bétons de haute performance.
Optimisation de l’épaisseur et du ferraillage
L’épaisseur du béton joue un rôle capital dans sa capacité à faire barrière à la chaleur. Plus la section est importante, plus la montée en température à cœur est ralentie. De même, un enrobage suffisant des armatures métalliques (minimum 4 cm selon l’Eurocode) protège le fer contre l’échauffement et prolonge la stabilité de la structure.
En complément, le dimensionnement du ferraillage doit être ajusté pour tenir compte des efforts mécaniques résiduels pendant un incendie. L’intégration de raidisseurs ou d’éléments porteurs mieux répartis permet également de retarder la déformation globale de la structure.
En synthèse : améliorer la résistance au feu du béton ne dépend pas d’un seul levier, mais d’un ensemble cohérent de choix techniques, à adapter au cas par cas selon les contraintes architecturales, structurelles et réglementaires du projet.
Usage concret et personnel : faire du béton un vrai allié contre le feu
Même si les données techniques sont rassurantes, la réussite d’un projet exposé au risque incendie repose sur des choix concrets, bien pensés et bien mis en œuvre. Voici comment faire du béton un allié fiable dans la prévention des risques liés au feu.
Pourquoi choisir le béton dans un projet exposé au risque incendie ?
Le béton, par sa nature minérale, est incombustible, non inflammable et n’émet aucun gaz toxique en cas d’incendie. Contrairement à d’autres matériaux structurels, il ne contribue en rien à la propagation des flammes.
Dans les secteurs à risque élevé (ERP, parkings souterrains, bâtiments industriels, logements collectifs), il offre une tenue au feu longue durée, sans déformation brutale ni effondrement rapide. Grâce à sa résistance thermique progressive, il laisse aux occupants un temps précieux pour évacuer, tout en protégeant les zones voisines.
C’est pour cette raison que le béton est utilisé dans les structures porteuses des grands projets, où la stabilité en situation d’urgence est non négociable.
Comment renforcer sa performance feu lors de la mise en œuvre ?
Même si le béton est naturellement résistant au feu, certaines bonnes pratiques sur le chantier permettent d’en décupler la fiabilité :
- Choisir une formulation adaptée : privilégiez un béton ZVB ou un béton fibré pour minimiser les risques d’éclatement ;
- Respecter un enrobage suffisant des armatures (≥ 4 cm) pour les protéger efficacement de la chaleur ;
- Optimiser les sections et la géométrie des éléments en béton selon leur exposition au feu (planchers, poteaux, murs) ;
- Ajouter des fibres de polypropylène au mélange pour permettre l’évacuation de la vapeur en cas d’incendie ;
- Prévoir une ventilation adaptée dans les espaces clos (sous-sols, locaux techniques) pour éviter l’accumulation de chaleur.
Ces choix ne se devinent pas : ils se construisent avec l’appui de professionnels du matériau et des bureaux d’études agrées, capables d’analyser les risques réels du site et d’y répondre avec des solutions sur mesure.
5 conseils concrets pour réussir votre chantier en toute sécurité
- Faites appel à un bureau d’études structures pour anticiper les sollicitations thermiques extrêmes.
- Exigez des bétons certifiés pour leur performance feu, testés en laboratoire selon les normes en vigueur (EN 1992-1-2).
- Évitez les formulations trop riches en eau, qui augmentent les risques d’éclatement thermique.
- Préférez des éléments préfabriqués pour bénéficier d’un meilleur contrôle qualité et d’un taux d’humidité plus faible.
- Formez vos équipes aux règles de l’art pour une mise en œuvre conforme aux DTU et aux exigences de sécurité incendie.
Bien conseillé, bien dimensionné, bien appliqué, le béton devient un véritable rempart contre le feu, à la fois économique, durable et protecteur.
Conclusion : un matériau stable, sûr et rassurant en cas d’incendie
Le comportement du béton face au feu n’est pas une légende urbaine : c’est une réalité mesurée, maîtrisée et exploitée dans tous les grands projets d’architecture et d’ingénierie. Sans être parfait, ce matériau offre une tenue au feu incomparable, une réaction neutre aux flammes, et une stabilité mécanique remarquable même dans des conditions extrêmes.
Sa fiabilité repose sur une alchimie précise : formulation, mise en œuvre, dimensionnement et anticipation des risques. C’est dans cet équilibre que le béton révèle tout son potentiel.
Pour aller plus loin sur les propriétés avancées de ce matériau, poursuivez votre lecture avec les articles suivants :
→ Comportement à l’eau du béton
→ Avantages structurels et thermiques du béton
.




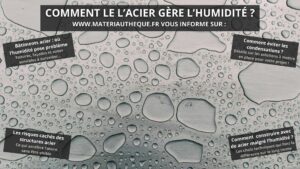







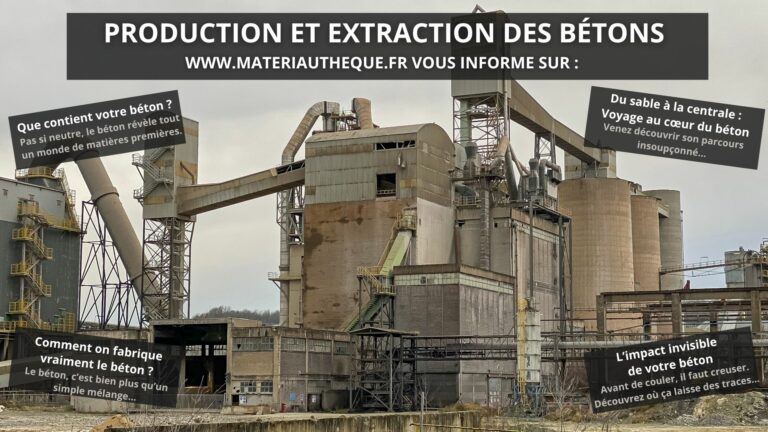


[…] Résistance au feu du béton […]
[…] Résistance au feu du béton […]
[…] Résistance au feu du béton […]
[…] Résistance au feu du béton […]
[…] Résistance au feu du béton […]
[…] Résistance face au feu des bétons […]