Le recyclage du béton
Le recyclage béton consiste à broyer les gravats de démolition ou les excédents de chantiers. Ces matériaux deviennent des granulats recyclés, réutilisables dans de nouveaux bétons. Cette pratique s’inscrit dans une logique d’économie circulaire. Elle réduit l’extraction de ressources naturelles et limite les déchets du secteur BTP. En France, le BTP produit chaque année près de 260 millions de tonnes de déchets, dont une grande partie provient du béton.
À la fois omniprésent et énergivore, ce matériau affiche un bilan carbone élevé en raison de son mode de fabrication et de son traitement en fin de vie. Face à ces enjeux environnementaux, le recyclage du béton s’impose comme une solution durable et stratégique. Il s’appuie sur des techniques de concassage, de tri et de contrôle qualité, permettant de réintégrer les granulats recyclés dans la fabrication de nouveaux bétons – pour des voiries, des fondations ou même des éléments structurels selon les normes en vigueur.
Le recyclage béton semble une solution prometteuse. Pourtant, il soulève encore des questions concrètes. Est-il vraiment plus écologique, une fois tous les coûts pris en compte ? Ses performances égalent elles celles du béton traditionnel non recyclé ? Et surtout, quelles sont ses limites techniques et réglementaires ?
Dans cet article, nous répondons à ces questions.
Le recyclage du béton : pourquoi c’est devenu une priorité environnementale ?
Un matériau omniprésent… mais énergivore
Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde, toutes catégories confondues. Routes, bâtiments, fondations, structures d’ouvrages publics ou privés : aucun chantier d’envergure ne peut aujourd’hui s’en passer. Pourtant, derrière cette omniprésence se cache une empreinte écologique massive.
Le principal facteur d’émission de CO₂ du béton est lié à la production de ciment, notamment à cause de son composant majeur, le clinker, dont la fabrication exige une cuisson à 1 450 °C. Cette seule opération représente plus de 90 % des émissions carbone du béton. À cela s’ajoutent :
- l’extraction de granulats (sables, graviers, roches), qui fragilise les écosystèmes ;
- les transports entre carrières, centrales BPE et chantiers, très dépendants aux énergies fossiles ;
- la gestion en fin de vie, souvent synonyme de stockage en décharge.
En résumé, même si ses composants semblent “naturels”, le béton neuf consomme énormément d’énergie, tout au long de son cycle de vie. Le recyclage apparaît alors comme une alternative crédible pour en limiter les impacts.
Pour en savoir plus sur les étapes de fabrication du béton, nous vous invitons à lire l’article : Production et extraction des bétons.
Objectifs nationaux et européens en matière de déchets BTP
Pour inverser cette tendance, l’Europe et la France ont fixé des objectifs ambitieux. La directive-cadre 2008/98/CE impose, depuis 2008, un objectif de 70 % de valorisation des déchets de construction et de démolition. L’objectif fixé pour 2020 a été atteint, voire dépassé. Aujourd’hui, le taux avoisine les 80 %, selon l’UNPG et l’ADEME.
Cette réussite s’appuie sur une forte mobilisation de la filière béton, notamment via :
- la création de centres de tri et plateformes de recyclage à proximité des zones urbaines ;
- la promotion de techniques de déconstruction sélective, plus favorables au tri ;
- des incitations fiscales et réglementaires favorisant le réemploi des matériaux.
Un nouvel objectif de 90 % est d’ores et déjà envisagé. Pour l’atteindre, l’enjeu n’est plus seulement de recycler “plus”, mais de recycler mieux, avec des performances techniques à la hauteur du béton traditionnel.
Le projet RECYBETON : des ambitions techniques au service du climat
Parmi les initiatives majeures visant à faire évoluer le secteur, le projet national RECYBETON fait figure de référence. Lancé en 2012, un consortium de 47 acteurs publics et privés (industriels, chercheurs, ingénieurs, architectes) a piloté ce programme. Il a exploré les possibilités de réutiliser les granulats béton dès la phase de conception des ouvrages. Ce travail a marqué une étape clé pour le recyclage béton dans l’ingénierie du bâti.
Ses travaux ont permis de faire avancer la recherche sur :
- la formulation de bétons structurels contenant jusqu’à 50 % de granulats recyclés ;
- les impacts du recyclage sur des paramètres clés : élasticité, retrait, résistance mécanique, ouvrabilité ;
- les méthodes de tri et de traitement les plus efficaces.
Toutefois, certains résultats restent à consolider. Les premières expérimentations ont montré que dès le premier cycle de recyclage, le béton peut présenter des variations de performance (perte d’élasticité, retrait accru, porosité plus élevée). Cela ne remet pas totalement en cause le recyclage, mais invite à une vigilance accrue sur les usages structurels. La recherche progresse et d’autres études devraient permettre prochainement d’améliorer les performances et le rendement du béton recyclé afin qu’il puisse être comparable à un béton neuf.
Le projet RECYBETON a néanmoins permis de franchir un cap en démontrant qu’un béton recyclé performant, normé et traçable est envisageable, à condition de maîtriser toute la chaîne : démolition sélective, tri fin, traitement et formulation précise.
Jusqu’où peut aller le recyclage du béton dans le réemploi des matériaux ?
Le béton, malgré son apparente homogénéité, dissimule une grande diversité de composants et de résidus en fin de vie. Tous ne sont pas égaux face au recyclage, et les contraintes techniques liées à leur traitement influencent fortement la qualité du matériau recyclé final. Identifier précisément ce qui peut être réemployé, dans quelles conditions, et pour quels usages, est la première étape vers un béton réellement durable.
D’où proviennent les matériaux utilisés dans le recyclage du béton ?
Le béton recyclé peut provenir de deux sources principales, aux caractéristiques très différentes :
- Les déchets de production : il s’agit de retours de béton frais, de béton durci ou non conforme en sortie d’usine (centrales à béton, préfabrication). Ces matériaux sont relativement propres, homogènes, et facilement valorisables. Ils peuvent être concassés ou lavés sans tri complexe.
- Les déchets de déconstruction ou de démolition : ils représentent la plus grande part des volumes disponibles, mais sont aussi les plus hétérogènes. Ils contiennent souvent des impuretés : plâtre, bois, plastiques, éléments ferreux, etc., qui exigent un tri rigoureux pour garantir la qualité du recyclat.
La qualité du tri initial fait donc toute la différence. Un béton récupéré en usine est beaucoup plus simple à recycler qu’un béton issu d’un ancien bâtiment en béton armé, mélangé à d’autres débris.
Les différents types de déchets du béton
Les déchets de béton sont généralement classés en trois grandes catégories, chacune ayant un potentiel de recyclage spécifique :
- Déchets de béton pur (armé ou non armé) : c’est la matière la plus directement réutilisable. Elle permet de produire des granulats de béton recyclé (GBR), utilisables en remblai ou potentiellement en structure.
- Mélanges de béton, briques, céramiques, mortiers : ces déchets sont plus difficiles à trier. Le recyclage est possible, mais le matériau final est souvent limité à des usages non structurels (sous-couches, remblais routiers).
- Déchets inertes divers (enrobés, tuiles, terres, cailloux) : peu exploitables tels quels, ils sont généralement stockés ou enfouis. Seule une fraction peut être réintégrée après traitement spécifique ou utilisée comme remblai technique. Les déchets inertes dangereux (amiante, goudron, houille, bétons contaminés des centrales nucléaires, etc.) doivent recevoir un traitement de décontamination.
Un tri insuffisant ou mal réalisé réduit significativement les usages potentiels du recyclat, voire le rend inapte à une valorisation autre que le comblement ou l’enfouissement.
Le cas particulier des granulats de béton recyclé (GBR)
Les granulats de béton recyclé (GBR) sont au cœur de la démarche de valorisation. Obtenus par concassage et criblage du béton démoli, ils remplacent en partie les granulats naturels dans certaines formulations. Actuellement, ces granulats servent principalement de remblais ou en sous-couche de chaussées.
Cependant, leur utilisation en béton structurel nécessite :
- une teneur élevée en béton pur, sans polluants ni inclusions indésirables ;
- une granulométrie contrôlée ;
- des propriétés physiques maîtrisées : densité, porosité, taux d’absorption d’eau, résistance à l’usure.
Par ailleurs, des traitements complémentaires sont parfois indispensables :
- traitement thermique pour détruire la pâte de ciment résiduelle ;
- traitement chimique (bain acide) pour améliorer la propreté de surface ;
- traitement mécanique par abrasion ou jet d’eau à haute pression.

Pour être de bonne qualité, les GBR doivent comporter une teneur élevée en béton. C’est pourquoi il faut toujours favoriser la déconstruction à la démolition. En effet, il est ainsi plus facile de décomposer les constituants du béton et de faire un meilleur tri complémentaire. Lors d’une démolition, le béton est souvent mélangé avec des matériaux rocheux ou contaminants (plâtre, bois, plastique, etc.). Pour les bâtiments dont la surface SHOB est supérieure à 1 000 m², un diagnostic pour identifier les déchets est obligatoire avant la démolition (décret n° 2011 — 0610 du 30 mai 2011). Cette obligation s’applique également aux bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux, avec ou sans stockage de produits dangereux.
Ces procédés, bien que performants, peuvent être énergivores et soulever la question du bilan écologique réel du recyclage : un béton recyclé ne doit pas coûter plus cher à l’environnement que le béton qu’il remplace.
Autres sous-produits valorisables : laitier et mâchefer
Le recyclage du béton ne se limite pas à ses propres gravats. D’autres sous-produits industriels peuvent contribuer à la formulation d’un béton plus durable.
- Le laitier de haut-fourneau, issu de la fabrication de l’acier, peut remplacer jusqu’à 50 % du clinker dans le ciment. Il améliore la résistance aux sulfates et réduit significativement l’empreinte carbone du béton final. Son usage est déjà courant dans les ciments CEM III.

- Le mâchefer, résidu obtenu après l’incinération du charbon ou des déchets dans les usines d’incinération, est plus controversé. Utilisé principalement en sous-couche de voirie, il fait l’objet d’expérimentations pour intégrer certaines formulations non structurelles. Des recherches sont en cours pour le transformer en matériau filtrant ou en liant partiel ou pour l’utiliser pour d’autres usages, comme pour traiter le biogaz à la place du charbon actif actuel, par exemple.

Ces sous-produits ne remplacent pas le béton recyclé, mais ils en complètent l’offre dans une logique d’économie circulaire multimatériaux.
Comment recycler du béton ? Entre démolition et déconstruction raisonnée.
Avant toute démolition d’un bâtiment, d’une route ou d’un équipement, les éléments contaminés (amiante, plomb, etc.) sont séparés du reste de l’ouvrage. En effet, la démolition ne doit pas être une source de pollution ou d’émissions de substances dangereuses pour les personnes situées à proximité du chantier.
La méthode la plus répandue pour obtenir du béton recyclé reste la démolition, notamment pour sa rapidité d’exécution. Toutefois, cette solution présente plusieurs limites en matière de tri et de valorisation des déchets.
Les techniques varient selon les contraintes du site et les objectifs de démolition :
- Méthode manuelle : Qui consiste à démolir d’abord la partie haute d’une structure, mais sans endommager les fondations (appelée méthode de « dérasement »). Des mini-engins de démolition sont hissés pour détruire le béton par le haut. Ou à l’inverse, la démolition peut s’opérer par le bas en réalisant des saignées au niveau des fondations (appelée méthode de « sapement »). Après chaque saignée, une cale est placée à l’endroit de la fente. L’effondrement est obtenu par la destruction des cales.
- Méthode mécanique : impliquant des pelles hydrauliques, boules de démolition, ou découpes à la scie diamant. Elle permet de traiter de grandes surfaces, mais génère souvent un mélange de matériaux difficile à trier.
Les engins de démolition



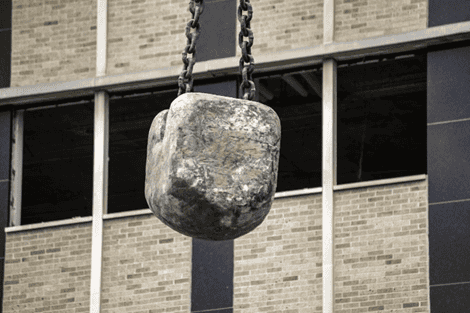

- Démolition par expansion : via vérins hydraulique ou un écarteur se glisse dans le trou pour exercer un écartement ou une poussée. Des fissures murales apparaissent, la maçonnerie éclate et se disloque. La démolition peut également se faire par l’utilisation d’agents chimiques expansifs (chaux vive hydratée), elle provoque l’éclatement du béton.
- Procédés explosifs : qui est réalisée par dynamitage après introduction d’une charge explosive dans un trou foré. Cette technique est encadrée par une équipe de spécialistes en explosifs.
- Procédés thermiques : qui consiste à découper les matériaux avec des outils thermiques, comme une lance à oxygène, une torche plasma, un laser ou avec un chalumeau.
- La démolition par procédés chimiques : Avec l’introduction d’un mortier expansif (à base de chaux vive hydratée) dans des trous forés. Sous l’effet de la dilatation et de l’expansion du produit chimique, la structure est déstabilisée et l’ouvrage s’effondre.
Le recyclage béton produit souvent des granulats de qualité hétérogène, surtout après démolition. Ces matériaux contiennent des résidus non béton comme du bois, du plâtre ou du métal. Un tri secondaire s’impose pour améliorer leur pureté. Mais sur les chantiers, ce tri reste rarement optimisé. Résultat : les GBR (granulats de béton recyclé) servent surtout à des usages non structurels, comme les remblais ou les sous-couches routières.
Recyclage via déconstruction : plus lente mais plus écologique
À l’inverse de la démolition, la déconstruction raisonnée mise sur un tri à la source. Elle consiste à démonter un ouvrage en séparant méthodiquement les différents matériaux avant traitement.
Cela permet :
- une identification précise des composants (bois, plâtre, plastiques, bétons),
- une valorisation maximale des éléments réemployables,
- une amélioration significative de la qualité des granulats recyclés, particulièrement adaptée à une réintégration dans du béton structurel.
Cette méthode s’appuie sur un diagnostic déchets préalable (obligatoire pour bâtiments > 1 000 m²), et sur un traitement local via des concasseurs mobiles ou des stations de tri embarquées.

Avantage majeur : la déconstruction facilite l’économie circulaire du béton tout en réduisant les nuisances sur chantier (poussières, bruit, volumes transportés).
Traitement des déchets de béton : quelles méthodes pour un recyclage efficace ?
Le recyclage béton ne se limite pas au concassage de gravats. Il s’agit d’un processus industriel complexe qui mobilise des équipements spécialisés et une réelle expertise technique. Chaque étape vise à produire des granulats béton recyclé (GBR) capables de respecter les exigences mécaniques, environnementales et réglementaires de la construction actuelle. Découvrons les trois grandes phases techniques de cette transformation.
Étapes de traitement du béton concassé
La méthode de déconstruction présentée ci-après est celle qui devrait être en théorie toujours appliquée. Dans les faits, la plupart des plateformes ont tendance à simplifier ce procédé (source : ADEME).
- L’extraction des éléments métalliques. Un premier tri est réalisé pour éliminer les matériaux ferreux avec l’aide de séparateurs magnétiques.
- Les déchets inertes sont retirés par des systèmes de tri (séparateurs manuels, pneumatiques, hydrauliques, etc.).
- Concassage : Ce broyage mécanique permet de fragmenter le béton en morceaux plus petits grâce à des concasseurs à mâchoires ou à percussion. Il s’agit d’obtenir une granulométrie exploitable, tout en réduisant la teneur en pâte de ciment résiduelle. Le concassage est obtenu avec un concasseur à mâchoires ou à percussion.
- Criblage : Une opération essentielle pour séparer les granulats selon leur taille (sables, gravillons, etc.). Le criblage peut être réalisé à sec ou par voie humide, en fonction de la qualité souhaitée.
- Dépoussiérage : Cette étape permet d’éliminer les fines particules. Elle est cruciale pour éviter l’encrassement des formulations béton. Elle peut être réalisée à l’air comprimé ou par lavage, bien que cette dernière méthode génère des eaux usées à traiter.

Photo d’un concasseur (source : société Hollinger)
Ces étapes visent à produire un matériau conforme à la norme NF EN 12620 relative aux granulats pour béton hydraulique.
Recyclage béton : zoom sur les différentes méthodes de tri utilisées
Le béton de démolition est souvent hétérogène (mélanges avec plâtre, plastique, bois, etc.). Pour produire des granulats de qualité, plusieurs technologies de tri sont utilisées :
- Le tri par densité (jig) : La technique dite de « jig » permet de séparer les constituants du béton à recycler en utilisant la force gravitationnelle. Les particules sont vibrées dans un fluide (air ou eau) par l’intermédiaire d’un trommel (tambour rotatif), de spirales ou d’un aquamoteur (système de vis sans vin partiellement immergée dans de l’eau). Les mouvements verticaux du fluide conduisent à un tri par phénomène de stratification densimétrique.
- Le tri par capteurs optiques : Des caméras haute vitesse et des logiciels de reconnaissance trient les matériaux selon leur couleur ou leur forme. Précis, rapide, sans contact.
- Le tri par capteurs proche infrarouge (NIR) : Ils identifient la composition moléculaire des matériaux à partir de leur signature spectrale. Idéal pour différencier le bois, les plastiques ou les céramiques.
- Le tri par détection par rayons X ou spectroscopie Raman : Technologies plus avancées, capables d’analyser la structure interne des composants pour un tri de haute précision, notamment dans les milieux industriels sensibles.
Plus le tri est précis, plus les granulats obtenus peuvent prétendre à des usages structurels (béton armé, béton prêt à l’emploi…).
Traitements de performance pour granulats recyclés
Pour améliorer la qualité des GBR et les rendre compétitifs face aux granulats naturels, différents traitements correctifs peuvent être appliqués :
- Traitements mécaniques
- Par abrasion : Avec une machine à abrasion, qui fonctionne avec une sorte de cylindre rotative contenant une charge abrasive (bille d’acier) et de l’eau. Cette méthode permet de tester la résistance à l’usure du granulat en le soumettant à des chocs ;
- Par sablage : le mortier est broyé grâce à un système d’arbre cylindrique ou conique en rotation ;
- Par jet d’eau haute pression (jusqu’à 3 000 bars) : Nettoyage et désagrégation ciblée.
- Traitements chimiques
- Par Bains d’acides : Le béton concassé est plongé dans un bain d’acide chlorhydrique, salicylique ou sulfurique pour une durée maximale de 24 h. Ainsi, le matériau se détériore et l’ensemble est lavé pour supprimer les résidus.
- Attention, l’impact écologique doit être surveillé (production de boues acides).
- Traitements thermiques
- Par chauffage à 300 – 700°C : Pour Dégrader la pâte de ciment sans altérer les propriétés des granulats.
- Par cycles gel/dégel répétés : Provoquent des microfissures ciblées pour séparation.
- Méthodes innovantes
- Par micro-ondes : Les granulés sont chauffés par ondes électromagnétiques dans le but d’entraîner des dilations différentielles jusqu’à déclencher la fissuration de la pâte de ciment.
- Par ultra-sons : La propagation d’ondes ultrasonores, en traversant les granulats, va générer un phénomène de pression (ondes réfléchies et transmises) et ainsi fissurer la matière. Ce système est reconnu pour être efficace, mais très consommateur en énergie.
- Par un traitement thermomécanique : Cette méthode combine celle du traitement thermique et mécanique. Le chauffage dégrade les granulats, ce qui facilite la séparation des composants par le cylindre en rotation.
Ces traitements permettent d’atteindre des granulats recyclés à haute valeur ajoutée, intégrables dans des bétons structurels de qualité.
Usage concret et personnel : comment intégrer le béton recyclé dans vos projets ?
Intégrer du béton recyclé sur un chantier, c’est plus qu’un geste écologique. C’est un choix technique réfléchi, aligné avec les normes en vigueur. C’est aussi un levier pour anticiper les enjeux de demain et renforcer l’image de marque de l’entreprise. Cette section vous accompagne, de façon concrète, dans l’adoption maîtrisée de ce matériau réemployé.
Pourquoi opter pour un béton recyclé bien formulé ?
L’adoption du béton recyclé répond à plusieurs motivations stratégiques et environnementales :
- Réduction significative de l’impact carbone : en remplaçant partiellement ou totalement les granulats naturels par des granulats de béton recyclé (GBR), on limite l’extraction de ressources vierges et on évite le transport longue distance. Cela contribue à réduire jusqu’à 30 % d’émissions de CO₂, notamment en zones urbaines denses.
- Disponibilité locale : les granulats recyclés sont souvent produits à proximité des centres urbains, à partir de la démolition d’anciens bâtiments ou d’infrastructures. Cela réduit les délais et les coûts de livraison.
- Amélioration de l’image RSE du projet : de plus en plus de maîtres d’ouvrage publics et privés exigent des démarches HQE, BREEAM ou Écoquartier. Intégrer du béton recyclé peut valoriser le bilan environnemental du chantier auprès des partenaires et des institutions.
C’est donc une stratégie gagnante à la fois sur le plan technique, écologique et économique.
Recyclage du béton : méthodes à privilégier selon le type de projet
Choisir la bonne approche de recyclage dépend de plusieurs critères liés au chantier :
- L’accessibilité du site : sur un chantier urbain restreint, des granulats recyclés issus d’une plateforme locale sont plus pertinents qu’un béton fraîchement concassé sur place.
- La qualité finale attendue : si le béton est destiné à un élément porteur ou soumis à des charges répétées, il faudra privilégier des GBR de classe 1 (faible taux de contaminants, granulométrie maîtrisée, taux d’absorption limité).
- En rénovation ou sur site patrimonial : misez sur la déconstruction sélective et le tri fin pour garantir un réemploi partiel sur place.
- Le volume nécessaire : pour des projets de grande ampleur, il est possible de contractualiser avec un centre de recyclage certifié pour des livraisons sur mesure.
- Les normes de performance : les bétons recyclés doivent respecter la norme NF EN 206/CN et le guide technique CSTB – Guide d’usage des granulats recyclés dans le béton.
Chaque chantier est une opportunité d’optimiser — le recyclé, bien utilisé, devient un levier plutôt qu’un compromis. Un bon projet commence donc par une analyse du contexte, suivie d’un dialogue précis avec les fournisseurs.
5 conseils pour réussir l’intégration de granulats recyclés
Voici une checklist professionnelle pour assurer la qualité et la conformité de votre mise en œuvre :
- Assurez la traçabilité des GBR
→ Exigez un certificat de provenance et de traitement : origine des déchets, procédé de tri, qualité des granulats. - Vérifiez la conformité à la norme NF EN 206
→ Elle précise les limites d’incorporation selon l’environnement d’exposition (humide, agressif, gel/dégel…). Respectez les classes XC, XD, XS, etc. - Collaborez avec des fournisseurs qualifiés
→ Privilégiez des producteurs membres du SRB (Syndicat du Recyclage du Bâtiment) ou labellisés Certivéa, pour une qualité constante. - Réalisez une analyse granulométrique précise
→ Vérifiez la distribution des classes granulo, la porosité, le taux de fines et l’absorption d’eau. Cela influera directement sur le rapport E/C. - Effectuez des tests de performance mécanique en amont
→ Testez le béton recyclé en conditions réelles : résistance à la compression, module d’élasticité, retrait, absorption, etc. Anticipez l’ajustement de formulation.
Conclusion : Recycler le béton, un levier concret pour une construction plus durable
À l’heure où le secteur du BTP est appelé à réduire son empreinte environnementale, le recyclage du béton apparaît comme l’un des leviers les plus tangibles pour agir à court et moyen terme. Loin d’être un simple effet de mode, il s’agit aujourd’hui d’un enjeu structurant, à la fois technique, réglementaire et écologique.
L’analyse du cycle de vie des matériaux, combinée aux ambitions européennes en matière de valorisation des déchets, confirme une tendance lourde : réutiliser les ressources déjà extraites, éviter l’enfouissement et maîtriser l’impact carbone de chaque chantier. Le projet RECYBETON, les avancées dans les technologies de tri, les traitements performants et les normes d’intégration dans les bétons structurels en sont la preuve concrète.
Cela dit, les limites techniques persistent : porosité résiduelle, retrait accru, compatibilité parfois délicate avec les adjuvants. Ces verrous nécessitent encore des ajustements fins en laboratoire et sur chantier, ainsi qu’un accompagnement renforcé des acteurs terrain. La déconstruction sélective et la traçabilité des flux restent, à ce jour, les conditions clés pour garantir une valorisation de qualité.
Pour élargir vos connaissances nous vous recommandons ces articles complémentaires de la Matériauthèque :
- Vulnérabilité particulière béton : pour comprendre pourquoi recycler permet aussi d’éviter certaines pathologies.
- Fabrication et transformation béton : pour voir comment le recyclé s’intègre dans les formulations actuelles.
- Transport et mise en œuvre du béton : Qui peut avoir une influence sur le bilan carbone et parce que aussi, un béton recyclé mal transporté ou mal coulé perd en performance.
- Entretien et maintenance béton : pour garantir la durabilité du matériau, même recyclé.




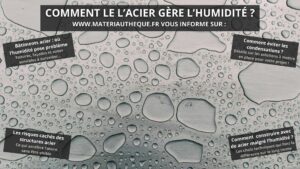







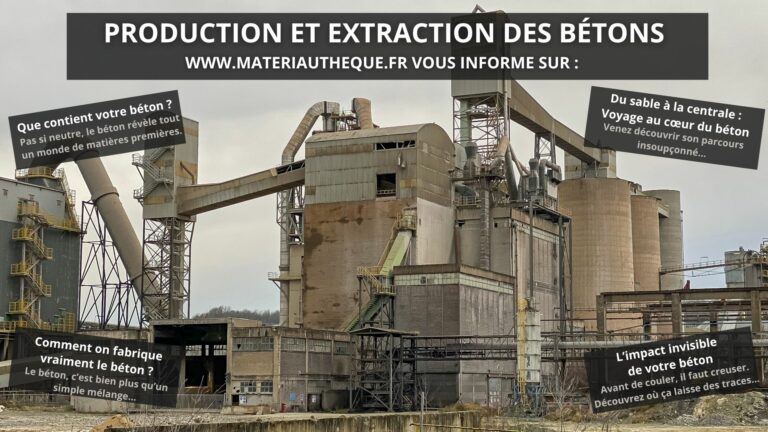


[…] Recyclage du béton […]
[…] Recyclage du béton […]
[…] Recyclage du béton […]
[…] Recyclage du béton […]
[…] Recyclage des bétons […]
[…] Matériauthèque | Comment s’effectue le recyclage du béton ? | […]